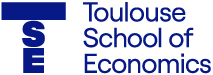Le lundi 10 décembre 2018, le groupe Casino a lancé le premier étiquetage spécifique au bien-être animal en France. Il présente quatre niveaux, A, B, C et D où D est le niveau « standard » et A est le niveau maximal dit « supérieur » de bien-être animal. Il s’appuie sur 230 critères prenant en compte toutes les étapes de la production : naissance, élevage, transport, abattage. Que penser de cette initiative ?
Il faut d’abord souligner que ce nouvel étiquetage est innovant et prometteur. Il est le résultat d’une longue collaboration réussie entre Casino et trois ONG reconnues pour leur expertise sur les animaux : Compassion In World Farming France (CIWF France), La Fondation Droit Animal, éthique et sciences (LFDA) et Œuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs (OABA). Il est aussi révélateur d’une évolution sociétale et d’une demande croissante des consommateurs pour un meilleur traitement des animaux d’élevage. Il est remarquable à cet égard de voir l'influent ancien patron de Renault, maintenant dirigeant de LFDA, Louis Schweitzer, porter une telle initiative.
Mais à ce stade, il convient également d’être très prudent. Les écueils sont multiples avant de déboucher sur une amélioration significative des conditions d’élevage des animaux, et les avancées restent modestes. En effet, cet étiquetage (qui devrait s’étendre) ne concerne pour l’instant que les poulets. Si l’on se penche sur les critères majeurs du confinement et de la date d’abattage, le niveau A introduit un nombre maximum de 11 poulets par m2 (au lieu d’environ 20 poulets pour le niveau standard), si bien que la densité reste élevée. Le niveau A introduit aussi un abattage minimum à 81 jours (au lieu d’environ 40 jours pour le standard). Ainsi, un poulet vivant normalement 8 ans ne pourra vivre que seulement 3% de son espérance de vie grâce au label supérieur.
Pour les consommateurs soucieux du bien-être animal, la meilleure réponse est certainement de réduire leur consommation de viande. Pourtant un autre désir peut dominer : continuer à manger de la viande sans se sentir coupable. Dans une étude sur le paradoxe de la viande, nous montrons avec mes coauteurs que les consommateurs ont en effet tendance à minorer la souffrance des animaux d’élevage, préférant éviter les informations sur les conditions d’élevage et cherchant des justifications à leur habitudes alimentaires. Ainsi, s'ils peuvent acheter à un prix à peine plus élevé de la viande perçue comme « éthique », et ainsi soulager leur bonne conscience, le succès sera au rendez-vous. Ces initiatives d’étiquetage peuvent donc participer à maintenir un niveau élevé de consommation de viande, plutôt que d’inciter les consommateurs à la diminuer.
De plus, toute certification est source de nombreux problèmes de contrôle. Qui va contrôler sur le terrain que les conditions d’élevage et d’abattage des centaines de milliers de poulets respectent tous les critères donnant lieu à cet étiquetage ? Les trois ONG qui participent comptent une vingtaine de salariés au total, déjà surement très occupés par ailleurs à faire avancer la condition animale, une goutte d’eau par rapport à la puissance économique du secteur producteur et distributeur. En pratique, ces initiatives volontaires ne peuvent être gérées que par et pour le secteur privé. Quelle sera la fréquence des contrôles ? Quelles seront les sanctions si les critères ne sont pas respectés ?
Un étiquetage similaire basé sur 5 niveaux a été développé en 2008 aux Etats Unis par Whole Foods en partenariat avec des ONG. Whole Foods a pourtant été accusé par d’autres associations de protection animale de tromperie auprès des consommateurs. Ces associations jugeaient que les contrôles étaient trop limités et inefficaces, et donc l’étiquetage pas assez favorable au bien-être animal. De plus, même si les améliorations du bien-être animal étaient importantes, et donc coûteuses, il y a fort à parier qu’un concurrent mettrait en place une autre auto-certification moins contraignante, et donc plus compétitive. Comment les consommateurs pourraient-ils alors s’y retrouver ?
Face à ces difficultés, la meilleure réponse reste la régulation des pouvoirs publics. Remarquons d’abord cyniquement que le secteur producteur fait du lobbying contre la régulation, comme ce fut le cas lors de la récente loi alimentation en France, alors qu’il développe en parallèle les initiatives privées, et les annonces de bonnes pratiques. Sur le bien-être animal, pourquoi seul l’affichage relatif aux œufs de poules pondeuses est-il rendu obligatoire dans l’Union Européenne ? Comment expliquer un tel manque d’information si ce n’est par le lobbying persistant de l’industrie depuis des décennies ? Seuls les pouvoirs publics ont les moyens de contrôler à grande échelle les pratiques de l’industrie. Et quand des contrôles sont effectués, ceux-ci révèlent souvent que l’industrie ne respecte pas la réglementation en vigueur sur le bien-être animal, comme l’a montré l’audit récent de la Cours des Comptes Européenne.
Dans ce contexte, il serait naïf d’attendre beaucoup de la part de l’industrie pour aller au-delà de la réglementation. Dans le domaine de l’environnement, on a vu se développer un greenwashing généralisé des industries polluantes, à l’image du scandale Volkswagen, une entreprise pourtant bien classée par les indices RSE. Le risque est grand de voir les industriels essayer de repeindre en vert ou en rose à coup de campagnes marketing l’image de ses produits, sans vraiment changer de pratiques. Avec la montée des débats sur les animaux et le véganisme, le retard de la législation par rapport à l’opinion publique et la complexité de la vérification sur le terrain, le risque est donc grand de voir apparaitre de l’animal welfare washing.