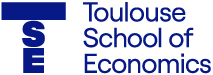Depuis 1985, on ne compte que quatre années où le taux de chômage a réussi à passer (très légèrement) sous la barre des 8%; sa moyenne sur cette période de trente ans est supérieure à 9%. On s’est donc progressivement habitué à faire tourner notre économie en laissant environ 10% de sa force de travail inoccupée: un gâchis à la fois humain, économique et financier, qui finit par être considéré dans le débat comme une contrainte externe, telle la pluviométrie.
En dépit des efforts de pédagogie des économistes, la mauvaise métaphore du partage du temps de travail s’est enracinée dans les esprits: un tiers des Français restent convaincus que partager le travail est la bonne solution pour baisser le chômage. Avec la désindustrialisation des économies modernes, le travail serait une denrée en voie de raréfaction, dont il s’agit de garantir un partage équitable. Suivant ce syllogisme, il ne faudrait surtout pas reculer l’âge de départ à la retraite, car les seniors prendront les emplois des jeunes. Cette croyance est particulièrement pernicieuse dans un monde où les retraites expliquent l’essentiel de la dérive préoccupante des dépenses publiques françaises par rapport à une Allemagne, qui, elle, n’a pas acheté ces balivernes malthusiennes.
Contrairement à ce que le clergé de la « fin du travail » voudrait nous faire croire, le potentiel de création d’emplois de l’économie française est énorme. Pour s’en convaincre, une idée simple est de regarder dans quels secteurs on observe en France un fort déficit d’emplois en comparaison d’une économie plus proche du plein-emploi. Cette comparaison, on peut par exemple la faire avec les Etats-Unis, qui présentent l’avantage d’avoir un « mix » sectoriel proche du nôtre. Nous réalisons cet exercice dans une note récemment publiée avec Sylvain Catherine par l’Institut Montaigne, et l’image qui s’en dégage est très claire.
Notre déficit d’emplois n’est pas dans les secteurs champions de la commande publique ou de la subvention que sont l’industrie et le bâtiment (nous avons plutôt un excès d’emplois dans ces secteurs), mais dans les services à la personne. Plus de la moitié du chômage français s’explique par un déficit d’emplois dans le commerce et l’hôtellerie-restauration (Thomas Piketty faisait il y a vingt ans un constat similaire). Le progrès technologique a fait disparaître de nombreux emplois d’ouvriers et de secrétariat, mais il augmente les besoins dans les métiers non automatisables. Singulièrement, l’éducation et la santé apparaissent immédiatement après dans la liste des secteurs atrophiés en emplois, en comparaison de l’Amérique.
Ces écarts ne s’expliquent pas par une préférence intrinsèque des Français pour moins de serveurs de restaurant, d’infirmiers ou de puéricultrices. Ils sont le reflet d’une contrainte : le coût du travail peu qualifié reste trop élevé. En imposant une hausse du SMIC trois fois plus rapide que celle du salaire moyen sur les deux dernières décennies, l’Etat a cherché à déléguer aux entreprises une tâche qui est de son ressort : la redistribution entre hauts et bas salaires. Le résultat est que le niveau de productivité qui est demandé aux travailleurs non qualifiés est artificiellement élevé, conduisant à ce sentiment de rareté de l’emploi. C’est d’ailleurs uniquement dans la population non qualifiée que se concentre le problème du chômage de masse. Pour les jeunes, la formation professionnalisante est probablement l’une des pistes à privilégier. Mais pour les 900.000 chômeurs de plus de 50 ans qui n’ont pas le niveau du bac, ce n’est pas une solution réaliste. Pour réintégrer ces personnes à la vie économique, il n’y a pas d’autre moyen que de baisser le coût du travail peu qualifié. Ne pas le faire, et continuer à nier le problème, conduit à une banqueroute humaine et financière.