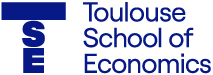D'un point de vue économique, la crise liée au Covid 19 diffère de celle de 2008. Dans cette dernière, des banques mal régulées et ayant pris des risques excessifs étaient au bord de la faillite. Cette faillite pouvait, par effet de domino, contaminer d'autres banques créancières des premières et les amener à leur tour à fermer. L'inquiétude était que ces faillites, ou à un degré moindre la réduction des activités de crédit, n'affectent les entreprises, en particulier les PME, qui auraient été asphyxiées par le tarissement de leur financements bancaires, impliquant réduction de l'activité et chômage en bout de ligne.
La situation aujourd'hui est différente. Ce sont les entreprises qu'il faut sauver. Ces dernières réduisent leur activité, soit parce que les services qu'elles produisent créent des risques importants de contamination des clients (restaurants, spectacles...), soit parce que leurs conditions de production nécessitent une proximité des travailleurs (usines). Avec un effet de ricochet inversé et des banques fragilisées par les moratoires sur les paiements des dettes qui leur sont dues et plus généralement par les pertessur leur actifs. Ceci explique que le plan de sauvetage porte à la fois sur les entreprises et sur le système financier.
Estimation du coût économique de la crise
Il est difficile d'en prédire le coût direct. Mes collègues à Toulouse School of Economics, Christian Gollier et Stéphane Straub, proposent une estimation « à la louche » fondée sur l'hypothèse d'un confinement de deux mois et réduisant de moitié l'activité économique, soit l'équivalent d'un mois de perte économique ou 8% du PIB annuel. Sachant qu'il faudra de douze à dix-huit mois afin de développer un vaccin, l'on n'ose imaginer le coût que représenterait un confinement alterné comme envisagé dans l'étude très influente d'Imperial College. Cette étude considère entre autres un confinement intermittent de deux mois sur trois, les mesures étant temporairement assouplies avant d'être réintroduites quand les contaminations repartent à la hausse.
A ces coûts directs s'ajoutent les coûts indirects, encore plus difficiles à chiffrer mais sans doute conséquents. L'activité après une crise ne repart pas du jour au lendemain.
Un scénario sombre
Si la crise sanitaire se prolongeait, les marchés financiers pourraient perdre confiance dans la valeur des obligations émises par les Etats, faisant planer le risque de crises souveraines.
Pour comprendre pourquoi, partons des sommes colossales que l'Etat devra dépenser pour sauver l'économie. L'Etat et la Banque Centrale aujourd'hui jouent à juste titre leur rôle d'assureur en dernier ressort en venant à l'aide des plus fragiles. Saluons au passage la solidarité dont ont fait preuve les gouverneurs de la BCE en débloquant rapidement des sommes très importantes pour assurer la stabilité financière.
Ces mesures de soutien budgétaires et monétaires viennent aider les travailleurs économiquement fragiles (CDD, salariés en fin de période d'essai, chômeurs perdant leur éligibilité à l'assurance chômage) qui, en faisant tous les efforts possibles, ne retrouveront pas d'emploi; les indépendants confinés ou sans clientèle qui perdent leur source de revenus; les PME et autres entreprises financièrement fragiles; les banques et les assureurs, eux aussi durement touchés par la crise; et enfin, dans la zone euro, les Etats dont la solvabilité peut être remise en question.
La dette des Etats va enfler, comme il est normal en temps de crise ou de guerre. Si la crise sanitaire perdure, certains Etats surendettés pourraient avoir de fortes difficultés à faire de nouveaux emprunts ou même simplement à renouveler ceux arrivés à terme; ils seraient alors dans l'incapacité de financer les nouvelles dépenses de santé, de payer leurs fonctionnaires et fournisseurs, ou de tenir les promesses faites aux particuliers, entreprises, banques et compagnies d'assurance pour éviter faillite et chômage.
Cette problématique prend une dimension particulière en Europe. La France n'a pas équilibré un budget depuis quarante ans et a vu ses dettes, officielle et non comptabilisée (le « hors bilan » : garanties diverses, déficits des régimes sociaux, retraites, etc.), augmenter lentement, mais inexorablement. Et elle n'est pas le plus mauvais élève. La Belgique, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal dépassent aussi les 100% du PIB en dette publique, pour certains beaucoup plus que la France.
Comme je l'explique dans Economie du bien commun, il n'y a pas de chiffre magique pour le maximum de dette qu'un pays peut soutenir. Si la pérennité financière d'un pays dépend de facteurs spécifiques bien identifiés (par exemple, un taux de croissance élevé et des taux d'intérêt bas, une capacité à augmenter l'impôt si nécessaire, une forte fraction de la dette détenue domestiquement), les attaques spéculatives sont aussi un phénomène autoréalisateur, donc difficilement prédictible. Quand un pays entre dans une zone où sa viabilité financière est en question, les investisseurs étrangers retirent leur argent s'ils pensent que le pays va faire défaut et restructurer sa dette, ce qui est effectivement le cas si les autres intervenants sur les marchés financiers font de même ! Une dette élevée n'est pas rédhibitoire tant que les marchés gardent confiance dans les Etats, mais devient critique autrement. Ironiquement, la croyance forte dans l'innocuité de l'endettement, reflétée de façon spectaculaire dans les divers programmes populistes des présidentielles de 2017 et de façon atténuée dans la vision de notre establishment depuis des décennies, pourrait justement mettre le destin du pays dans les mains de marchés financiers internationaux dont ils se méfient considérablement !
La nécessaire reprise d'une activité
Pour éviter une telle situation, l'aide au niveau microéconomique doit généreuse seulement pour les personnes et les entreprises qui en ont le plus besoin. Par exemple, l'envoi d'un chèque pour tous n'aurait pas beaucoup de sens; il n'y a pas besoin d'aider ceux qui ne sont pas en difficulté ou les entreprises qui ont peu souffert de la crise sanitaire. Au niveau macroéconomique, il faudra pour relancer l'activité dépenser pendant longtemps en s'affranchissant des règles budgétaires habituelles. Raison de plus de résister à la tentation de l'open bar.
De plus, en consultation avec les autorités sanitaires, il faudra faire en sorte que, dans le respect de la protection de la santé des individus, l'interruption d'activité ne perdure pas. Une période de confinement de plusieurs mois comme envisagée par les scénarios du rapport d'Imperial College serait extrêmement coûteuse; de plus plane le risque d'un non-respect des consignes, voire d'une désobéissance civile de grande ampleur par des citoyens excédés par l'absence d'interaction sociale directe et un ennui profond, quand ce ne sont pas les difficultés financières. Elle aurait aussi des conséquences invisibles à court terme, mais très coûteuses à long terme, comme le retard éducatif pris pendant cette période.
Il n'y a aucune raison que les personnes ayant développé une défense immunitaire au Covid-19 ne se voient pas décerner un laisser-passer et ne retournent pas au plus vite à leur activité. Mais cela nécessite des tests . En fait un double test, comme le préconisent une équipe de l'Université Libre de Bruxelles : l'un pour déterminer l'immunité de l'individu (test sérologique) et l'autre vérifiant qu'il n'est plus porteur du virus (test RT-PCR). Une mise en oeuvre progressive de ces deux tests permettrait de maintenir l'activité économique tout en minimisant le risque d'un retour en force de l'épidémie lorsque les mesures de confinement seront levées.
D'autres propositions ont été faites allant dans le même sens. Les laisser-passer octroyés aux individus immunisés et non-porteurs pourraient être complétés par des tests hebdomadaires, des capteurs thermiques, le traçage GPS des téléphones (sous strict contrôle pour protéger la vie privée des individus), et toute autre méthode permettant de protéger de l'épidémie ceux qui ne sont pas encore immunisés. Des mesures simples comme un dépistage systématique suivi d'un traçage et la mise en quarantaine des contacts et collègues de travail de l'individu contaminé semble avoir porté des fruits en Allemagne.
Qui va payer ?
In fine, quelqu'un paiera cette perte d'activité. Il y a plusieurs hypothèses et bien malin celui qui peut prédire celles qui prévaudront.
Première hypothèse : la répudiation de la dette publique existante (appelée en termes pudiques « restructuration »). C'est une solution très risquée, car la confiance en l'Etat en serait affectée. Ne pouvant plus emprunter, cet Etat serait obligé d'équilibrer son budget immédiatement, ce qui serait particulièrement délicat à un moment où il faudra continuer à payer les dépenses courantes,relancer l'économie, investir dans les hôpitaux et la recherche médicale, récompenser le personnel de santé pour son travail pendant la crise sanitaire, mettre en oeuvre les réformes structurelles, etc.
Deuxième hypothèse : L'impôt. Les Etats dégonflent la dette publique en diminuant les dépenses ou en augmentant les impôts. Les Etats prélèvent des taxes exceptionnelles sur les plus aisés, par exemple sur le patrimoine, ainsi que, pour faire face aux forts besoins en finances publiques, sur les classes moyennes. Une forme déguisée de l'impôt est la création d'une souscription obligatoire des banques à de nouvelles émissions de bons du Trésor, ceci à des taux d'intérêt ne reflétant pas l'inflation qui s'ensuit. L'inflation est en effet un grand classique de l'après-guerre.
La dette publique accumulée est résorbée en forçant les banques à acheter cette dette à un prix surévalué (c'est ce que les économistes appellent la « répression financière ») : les nouveaux emprunts de l'Etat sont bon marché pour ce dernier. C'est ainsi que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont réduit leur dette publique au sortir de la grande dépression et la deuxième guerre mondiale.
Ceci dit, une souscription obligatoire serait particulièrement délicate en zone euro. Elle nécessiterait un accord entre les pays sur le degré de répression financière autorisé dans chaque pays. De plus, elle perpétuerait et aggraverait même une forme de prise de risque déjà acceptée par les autorités prudentielles depuis la crise de la zone euro, et ce dans un contexte où les banques sont fragilisées par la crise sanitaire Ce dernier point est un peu technique. Aujourd'hui, à titre d'exemple, les banques italiennes possèdent beaucoup de dette de l'Etat italien. Bien que la valeur de la dette publique italienne pourrait diminuer du fait d'une restructuration possible de cette dette, les régulateurs bancaires n'exigent pas d'elles d'avoir des fonds propres leur permettant de résister à une perte de valeur de cette dette. Ce manque de fonds propres, qui s'applique aux dettes des pays de l'OCDE en général, est particulièrement risqué dans le cas de la dette de l'Etat italien, car les difficultés du pays rejaillissent sur les banques, et vice-versa le renflouement des banques insolvables aggrave les problèmes de finances publiques (les économistes appellent ce phénomène la « boucle de la mort »). Une souscription obligatoire augmenterait la quantité de dette italienne détenue par les banques italiennes et la surévaluerait dans leurs bilans en négligeant les pertes futures dues à l'inflation et à la possibilité de restructuration. Troisième hypothèse : la monétisation de la dette.La Banque Centrale rachète de la dette publique (ou la dette de banques que l'Etat soutiendrait de toute façon en cas de difficulté). Cette dette en principe doit se faire sur le marché secondaire et être remboursée à terme. Ces deux contraintes sont cependant plus formelles que réelles : la nouvelle dette italienne peut être achetée sur le marché primaire par une banque italienne qui la vend ensuite à la BCE (la frontière entre marchés primaire et secondaire, entre achats et rachats, est poreuse). Et il n'y a pas d'échéance formelle pour le remboursement par les Etats; un rachat supposé temporaire peut de facto devenir permanent.
Les rachats de dette par la Banque Centrale sont présumés inflationnistes. Mais il y a débat quant à la reprise de l'inflation. Il n'y eut pratiquement pas d'inflation suite à l' « assouplissement quantitatif » par les banques centrales en réponse à la crise des subprimes. Les banques centrales procédèrent à des rachats massifs de dette publique et bancaire après 2008. Cet accroissement considérable de liquidité aurait dû augmenter la demande, poussant les prix à la hausse. C'était cependant oublier les anticipations déflationnistes et la thésaurisation par les ménages, entreprises et institutions financières (les banques en particulier accumulant des réserves auprès de la Banque Centrale). L'inflation pourrait-elle redémarrer demain après une forte création de monnaie par la banque centrale ? Nul ne le sait. Si cela devait arriver, les « payeurs » seraient les détenteurs de fonds en euros et de comptes courants, qui, à l'exception de rares emprunts indexés à l'inflation, sont libellés en valeur nominale.
La monétisation de la dette pourrait être une option intéressante, mais à deux conditions. La première est de faire attention aux plus démunis, dont les seules économies se trouvent être logées dans un compte en banque. La seconde, et « l'éléphant dans le magasin de porcelaine » dans le cas de la zone euro, est de garder la discipline budgétaire au sein de la zone euro, dans une situation où tout gouvernement pourra dépenser librement en en mutualisant les conséquences avec les 18 autres pays de la zone. Il faudra pour cela réinventer le Pacte de stabilité, pour qu'il permette les fortes dépenses nécessaires au redémarrage de l'activité tout en gardant pérenne cette solidarité. Les monétisations de dettes publiques dans le passé n'impliquaient pas plusieurs pays, une monnaie unique, une banque centrale commune, et des niveaux de dette et de tolérance à l'inflation très différents selon les pays.
Quatrième hypothèse : la solidarité entre pays, c'est-à-dire l'acceptation par les pays dont les finances publiques sont restées solides de se porter garantes d'autres pays plus fragiles. Cette solidarité peut être difficile à mettre en oeuvre à un moment où tous les pays sont fortement impactés par le coronavirus. Mais il y a des antécédents, tel que le plan Marshall après la deuxième guerre mondiale (avec des visées géopolitiques, comme pourrait en avoir aujourd'hui la Chine) et la solidarité européenne dans la crise de l'euro lors de la dernière décennie face à des attaques spéculatives mettant l'Europe du sud en difficulté. L'argument en faveur de la solidarité européenne est encore plus fort que dans le passé. Par exemple, l'Italie n'est pas responsable de la pandémie. Cependant, au moment même où l'Europe devrait se porter totalement solidaire, cette même Europe pourrait être réticente à le faire, car l'Italie a abordé la crise sanitaire avec un endettement excessif.
Plusieurs mécanismes de mutualisation sont en place dans la zone euro. J'ai déjà mentionné les mécanismes de rachat de dette bancaire et souveraine par la BCE. Le Mécanisme européen de stabilité lui permet de lever jusqu'à 700 milliards d'euros sur les marchés financiers, grâce à une garantie de l'Union Européenne, mais est difficile à mettre en oeuvre car il requiert l'unanimité des 19 ministres des finances de la zone euro. De plus, il ne peut aider les Etats et les banques en difficulté que sous conditions.
Un troisième mécanisme, la mutualisation de la dette, est sur la table : de nombreuses voix - ainsi que neuf pays d'Europe du sud, dont la France - ont proposé une émission jointe de « coronabonds », reprenant ainsi l'idée des « eurobonds » qui avaient joui d'une certaine popularité après la crise de 2008, mais n'avaient pas vu le jour.
La mutualisation des dettes serait bénéfique à l'Europe du sud, mais elle me semble comme dans le passé peu probable. Comme je l'ai exprimé dans ma recherche, la solidarité est plus facile à organiser quand les pays sont de solidités financières similaires, c'est-à-dire quand chaque pays peut être le bénéficiaire comme le perdant de la solidarité. De même que vous ne signerez pas un contrat d'assurance nous portant garants l'un de l'autre si vous savez que je croule sous les dettes, il est peu attrayant de s'engager à partager le risque de l'emprunt avec des pays déjà surendettés. L'asymétrie des points de départ autorise toujours une forme de solidarité mue par l'empathie ou les intérêts bien compris (conséquences géopolitiques ou pertes économiques liées à un défaut de paiement de l'autre pays), mais cette solidarité, que l'on a observée dans la crise grecque, est nécessairement limitée.
Le soutien par la BCE me semble donc plus probable qu'un soutien budgétaire : il est plus rapide à mettre en place, ne requiert pas l'unanimité, et surtout il est moins transparent pour les opinions publiques des pays de l'Europe du nord, moins endettés (l'Allemagne a réduit sa dette à moins de 60%) et inquiets d'avoir à financer l'Europe du sud.
Copyright LES ECHOS
Photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash