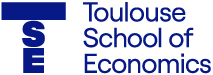Nous sommes économistes, spécialisé pour le premier en théorie de la décision en incertitude, avec applications à la finance, la macroéconomie, le climat, l’assurance, la prévention des risques et l’évaluation des politiques publiques, pour le deuxième en économie du développement, avec applications aux infrastructures, aux achats publics, et aux institutions. Bien sûr, il n’existe pas à ce jour d’économiste complètement légitime sur le coronavirus, et nous n’avons aucune revendication dans ce sens. En pleine crise sanitaire, il reste encore beaucoup d’inconnues au plan humain, médical, économique et financier. Et pourtant, des décisions doivent être prises très rapidement. Beaucoup le sont déjà. Les scientifiques disposent de connaissances utiles mais partielles et incomplètes. Ils ont la responsabilité d’en faire part aux opinions et décideurs publics, tout en reconnaissant leurs doutes et les incertitudes qui entourent ces connaissances. Cela met les scientifiques impliqués autant que les décideurs publics dans une situation très inconfortable, avec la quasi-certitude de se faire critiquer a posteriori par des citoyens souvent sujets au biais de rétrospection (« hindsight bias »), qui consiste à juger de l’optimalité d’une décision passée à l’aulne d’informations non disponibles au moment de cette prise de décision. Aujourd’hui déjà s’élèvent des voix dans ce sens. Ce sera pire demain. Anticipons une nouvelle détérioration de la confiance des peuples envers leurs élus.
Evaluation des impacts
La crise du covid-19 n’a pas d’équivalent dans l’histoire moderne, ni par son intensité, ni par son traitement. La grippe espagnole a tué entre 50 et 100 millions d’êtres humains entre 1918 et 1920, mais les conditions de l’époque n’ont pas conduit à une stratégie de confinement au niveau des Etats. La grippe asiatique (H2N2) aurait fait 2 millions de morts de 1956 à 1958, dans un contexte où le réseau de surveillance international était encore peu développé. Le covid-19 semble avoir une vitesse de propagation et un taux de mortalité bien supérieur à ceux d’une grippe. Dans la politique du « laisser-faire » un moment invoquée en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas par exemple, certains épidémiologistes évoquent un scénario impliquant une contamination de 70% de la population et un taux de mortalité de 2% parmi les contaminés, impliquant un taux de décès de 1.4% de la population. Pour la France, cela se traduirait par une surmortalité de pratiquement 1 million de personnes. Nous ne sommes pas plus capables que vous de juger de la fiabilité d’une telle estimation, et son intervalle de confiance est probablement considérable. En l’absence de certitudes sur les différents paramètres de l’épidémie, nous devrons continuer à faire des choix en tenant compte de ces doutes et de cette incertitude.
Bien sûr, il faut espérer que la politique sanitaire permette de réduire fortement ce bilan apocalyptique. Considérons par exemple la politique de confinement mise en place en France depuis le mardi 17 mars. Le travail est, avec le capital, la source de la création de richesse. Pour un individu isolé (« Robinson Crusoé »), ne pas travailler, c’est ne pas produire, c’est ne pas consommer. Ce qui est vrai au niveau individuel l’est aussi au niveau collectif. On ne peut pas distribuer des richesses qu’on n’a pas produites. Le confinement conduit à une version dégradée du travail, et souvent à l’arrêt complet de la production. Le télétravail permet heureusement pour beaucoup de maintenir une activité créatrice de valeur, mais il est aujourd’hui encore très difficile de mesurer son impact sur l’activité. On ne connaît pas non plus la durée de cette dégradation de la production. Pour fixer les idées, partons d’une estimation rapide, « de coin de table ». Imaginons 2 mois de confinement ferme impliquant une réduction de moitié de l’activité économique. Cela conduit à 1/12 de non-création de richesse, c’est-à-dire 8% de perte de revenus. Si on ajoute un retour à la normale seulement progressif d’ici à la fin de l’année, on atteint aisément une perte de plus de 10% du PIB dû à la politique de confinement. Les marchés financiers semblent partager cette estimation, avec une chute des cours de l’ordre de 40% à l’heure où nous écrivons ces lignes. Comme, dans notre société capitaliste, les fonds propres des entreprises sont en première ligne pour avaler cette perte massive de revenus, ces deux mesures sont compatibles l’une avec l’autre.
Une chute de 10% du PIB n’est certes pas anodine, mais si elle était équitablement répartie sur l’ensemble de la population, elle ne signifierait pas la fin du monde. Surtout, elle sera certainement temporaire. En effet, une fois le confinement levé, la population retrouvera son travail si la politique économique est capable d’éviter entretemps une cascade de faillites d’entreprises. On peut même imaginer dans ce cas un rebond de croissance en 2021, les entreprises cherchant à reconstituer leur stock mis à mal par l’arrêt de production cette année, et les consommateurs réalisant les achats qu’ils n’ont pu faire pendant le confinement. A titre de comparaison, rappelons que les grecs ont perdu environ 30% de leur revenus annuels, et que le retour à l’ère d’avant la crise de l’euro n’est pas prévu pour ce pays avant longtemps. La France a perdu 16% de son PIB durant la crise de 1929, 31% à cause de la première guerre mondiale et 49% à cause de la seconde guerre mondiale, avec une pérennité du choc bien plus longue que ce qu’on peut anticiper pour le covid-19. Ainsi, le choc actuel est rude, mais il n’est pas aussi catastrophique que ceux vécus par nos parents et grands-parents.
L’Etat comme assureur en dernier ressort
Néanmoins, en l’absence d’intervention publique, la réalité sera certainement bien différente d’une chute uniforme des revenus de 10% cette année avec un retour à la normale l’an prochain. Au niveau des ménages, elle frappera bien plus durement les plus précaires, les intermittents, ceux dont l’emploi n’est pas pérenne ou est crucialement limité par le confinement, sans même parler des personnes sans-abri ou des refugiés. De même, certains commerçants (restaurateurs, voyagistes, etc.) vont perdre beaucoup plus, et nombreux parmi eux pourraient faire faillite. Des grandes entreprises vont elles aussi être confrontées à de grandes difficultés financières. On peut citer les compagnies aériennes, les constructeurs automobiles, les chaines hôtelières, les salles de concert, les clubs de foot, etc. Les fonctionnaires, les prestataires de service dans le secteur de l’internet, l’agro-alimentaire et les commerçants des services essentiels ne perdront eux pas grand-chose. La stratégie de confinement est un sacrifice collectif nécessaire pour le bien commun. Cet effort doit être équitablement partagé du point de vue économique et financier. C’est un impératif autant moral qu’économique. Sous le voile de l’ignorance, sans savoir si nous sommes fonctionnaire ou restaurateur, nous voudrions tous qu’il en soit ainsi. La solidarité ex-post, c’est l’assurance ex-ante. Seul l’Etat peut mettre en place un tel mécanisme d’assurance en dernier ressort. Il appelle à une socialisation systématique des pertes économiques et financières dues au confinement.
Les économistes ont depuis longtemps mis en avant l’opposition qui existe entre l’impératif de responsabiliser les individus et les entreprises d’une part, et de partager les risques efficacement d’autre part. Renforcer l’assurance, c’est souvent réduire l’incitation à prévenir efficacement le risque. Mais dans le cadre du covid-19, cette réticence à partager le risque fondée sur ce « risque moral » n’a pas de raison d’être. Nous sommes donc dans une situation très différente de celle de 2008 (crise des subprimes) et de 2011-12 (crise de l’euro) où l’argument du risque moral avait indiscutablement un fondement empirique : les banques déterminent le risque lié à leur portefeuille de prêts ; les Etats déterminent le risque lié aux obligations qu’elles émettent. La socialisation des pertes pouvait être interprétée comme une absolution des mauvais comportements passés, et une licence pour recommencer. Le covid-19 et le confinement associé sont la combinaison d’un fait de dieu (« act of god ») et d’une décision politique, et aucun acteur n’a la possibilité d’intervenir pour les prévenir. Il ne peut y avoir de stigmatisation des victimes du confinement.
Comment traduire cet impératif de socialisation des pertes ? Il s’agit d’un transfert de ces pertes liées au confinement des ménages et des entreprises vers les comptes de l’Etat. Il faut compenser les victimes, et seulement elles. Le report de charges sociales et fiscales peut être utile à court terme pour desserrer l’étau sur la trésorerie des PME, mais ne constitue pas un instrument de socialisation des pertes. L’interdiction de licenciement constitue un transfert de charge du confinement des salariés vers les entreprises. Il n’est viable qu’à très court terme parce que sa pérennisation risquerait de mettre sur la paille beaucoup d’entreprises incapables de maintenir leurs dépenses de salaire en l’absence d’un flux concomitant de recettes. Heureusement, la situation en France est très différente de celle par exemple des Etats-Unis, parce que nous disposons d’un système de sécurité sociale bien plus efficace et généreux. Idéalement, il faudrait pouvoir recourir au chômage technique avec maintien de 100% de la rémunération pendant toute la période de confinement. L’Etat devrait aussi compenser la perte de revenu des travailleurs indépendants obligés d’interrompre leur activité par le versement d’un chèque (ou d’une remise fiscale) proportionnel à la durée de cette interruption, et sur base des revenus déclarés de 2019. Ce ciblage est en cela différent de la solution bipartisane du Congrès américain consistant à envoyer un chèque à tous les ménages, qui n’a donc pas de justification économique dans les circonstances actuelles. Cet « helicopter money » n’est utile que s’il s’agit de réagir à un choc de demande, ce qui n’est pas (encore) le cas. Bien sûr, il risque d’y avoir des trous dans la raquette et des profiteurs. Les économistes travaillant sur les transferts sociaux savent bien que le ciblage n’est jamais parfait, mais l’urgence et l’intensité de la crise justifient quelques pertes en ligne.
La compensation des pertes par l’Etat est aussi un moyen pour que ce choc de production n’engendre pas en plus un choc de demande. En maintenant le pouvoir d’achat des ménages, on coupe la propagation du choc dans le temps. Il faut savoir être keynésien quand la situation l’impose. L’Etat doit aussi s’assurer que l’appareil industriel reste intact en empêchant les faillites d’entreprises. Une recapitalisation par une prise de participation temporaire de l’Etat dans le capital de certaines entreprises pourrait s’avérer nécessaire. Comme en 2008, si le rebond économique se confirme, cela pourrait même se faire sans coût pour le contribuable.
Finalement, il faut être conscient que la politique de maintien de la demande alors que la production et l’offre vont chuter cette année peut conduire à un petit sursaut temporaire de l’inflation. Ce regain d’inflation serait plutôt le bienvenu en Europe mais il va dépendre de la durée du contre-choc pétrolier déclenché récemment.
Endettement et auto-assurance
L’opinion publique a aujourd’hui bien compris la nécessité d’aplatir la courbe des cas de contamination. Mais il y a une deuxième courbe à aplatir, celle de la baisse des revenus consécutifs au confinement que ce premier aplatissement nous impose.
Cette socialisation des pertes va se traduire par un déficit public massif en 2020, peut-être aux alentours de 10% du PIB, et une augmentation de la dette publique d’autant, qui devra être graduellement remboursée. Cette politique de socialisation des pertes et de lissage intertemporel du choc est économiquement désirable. On sait bien que l’incertitude qui pèse sur les revenus d’un ménage peut être efficacement gérée par l’accumulation d’une épargne de précaution liquide. Ce coussin de sécurité est abondé dans les périodes de revenus élevés pour être utilisé dans les périodes de faibles revenus. Cette auto-assurance est utilisée depuis toujours par les ménages qui le peuvent, mais n’est que trop peu possible pour les plus modestes. Ces derniers sont souvent contraints de répercuter 1-pour-1 les pertes de revenu en perte de consommation, avec des conséquences pouvant être dramatiques en cas d’impossibilité à emprunter.
Ce qui est optimal pour un ménage l’est aussi pour un Etat. Sa politique d’accumulation de capital (infrastructures et participations publiques) et d’endettement traduit cette nécessité de lissage intertemporel des chocs macroéconomiques. Hélas en France, la marge de manœuvre du trésor public est réduite et l’Etat dispose de peu d’actifs dont il pourrait se défaire pour financer ce choc. De plus, compte tenu du niveau de valorisation des bourses (le CAC 40 par exemple a perdu près de 40% en un mois), il serait peu judicieux de se défaire aujourd’hui d’Aéroport de Paris, d’EDF ou des actifs cantonnés dans le Fonds de Réserve des Retraites. Depuis des décennies la France accepte de laisser filer les déficits durant les récessions sans jamais réduire sa dette quand c’est possible. La démocratie est en ce sens la dictature du présent. Cette indiscipline s’est renforcée depuis la création de l’euro et la fin concomitante du mécanisme de punition automatique de cette indiscipline par la dévaluation que les marchés financiers lui infligeaient. Rappelons-nous la crise grecque. Si un jour, nous atteignons des niveaux d’endettement qui pourraient tenter un futur gouvernement à sortir de l’union monétaire et à faire défaut, le risque est que l’anticipation d’un tel événement conduise à l’impossibilité du pays à refinancer sa dette ou à amortir un nouveau choc, avec des conséquences sociales dramatiques pour le pays. Il est évidemment inutile de s’appesantir dans les circonstances actuelles sur ce problème de stabilité financière et de rationalité de la dépense publique. De ce point de vue, la suspension des règles de discipline budgétaire des traités européens est la bienvenue dans ces circonstances. Mais ce problème d’incapacité à équilibrer le budget public sur un horizon long devra bien un jour être traité. Pourquoi la France serait-elle éternellement incapable de faire ce que l’Allemagne fait depuis des décennies ? Il s’agit là sans aucun doute d’une des questions macroéconomiques majeures qui seront sur la table après cette crise.
La première conséquence de ce lissage du choc par l’endettement public porte sur sa mesure en termes de PIB à court terme. La politique de transfert public en faveur des victimes du confinement fera que la baisse du PIB pourrait être réduite à pratiquement rien en 2020. L’essentiel de la perte de PIB serait reporté sur les années suivantes, lorsqu’une partie de la création de richesses sera neutralisée pour rembourser la « dette corona » plutôt que d’être traduite en revenus consommables.
La France n’est heureusement pas en première ligne dans cette exposition au risque de dette souveraine. L’Italie a la malchance d’être le pays européen le plus touché par la pandémie. Elle est aussi un des pays européens les plus endettés. La nature exogène du choc économique retire ici aussi tout problème de risque moral et de la stigmatisation qui lui est associée. C’est l’ensemble de l’Union Européenne qui devrait socialiser la perte sur notre continent. Si l’Union n’exprime pas cette solidarité dans le contexte de cette pandémie, elle perdra beaucoup de la crédibilité qui lui reste en tant qu’entité politique à part entière. C’est d’autant plus vrai que la politique ferme de confinement en Italie a eu un effet bénéfique pour le reste de l’Union. Cette perte devrait donc être mutualisée à travers l’émission d’un « corona-bond » européen avec responsabilité conjointe des Etats pour son remboursement. A défaut, la BCE devrait s’assurer que les conditions d’endettement des Etats ne divergent pas au sein de l’Union. La règle plafonnant les achats de dette souveraine, dans le cadre du Mécanisme Européen de Stabilité, devrait être exceptionnellement suspendue. L’écartement récent des spreads de rendement des obligations d’Etat au sein de l’Union devra être contenue. Le lancement par la BCE des 750 milliards du programme d’achat d’urgence pandémique (PEPP) répond au moins partiellement à cette inquiétude.
A court terme, la BCE doit aussi éviter une crise de liquidité en offrant du cash à toutes les institutions financières qui le demandent. Ceci de manière à ce que ces dernières puissent à leur tour financer les entreprises solvables confrontées à des échéances difficiles. La socialisation des pertes par les Etats devrait permettre de rassurer les banques sur la solvabilité de leurs emprunteurs.
Evaluation de la politique sanitaire
Il y a beaucoup de choses à dire sur la gestion de la crise sanitaire en tant que telle. Commençons par l’appel au civisme. Début mars, le gouvernement français a compté sur le civisme des citoyens pour les inciter à se comporter de façon responsable. Les médias se sont largement fait l’écho de l’échec de cette politique. Pourquoi la pédagogie n’a-t-elle pas suffi ? Beaucoup de citoyens ont exprimé leur refus des gestes élémentaires de prévention en expliquant qu’ils étaient prêts à prendre le risque pour eux-mêmes. Comprennent-ils que leur comportement n’affecte pas que leur survie, mais aussi celle des autres ? Il y a deux explications possibles à ce manque de civisme. La première consiste à penser que ces gens n’ont en effet pas vraiment compris cette externalité négative, similaire à celle de ceux qui refusent la vaccination pour d’autres maladies. La deuxième explication, c’est que cette externalité est comprise mais n’est tout simplement pas prise en compte par les individus plus concernés par leur propre bien-être que par le risque que leur comportement engendre pour les autres. C’est un peu comme pour le réchauffement climatique.
Dans les deux cas, vos efforts me protègent et mes efforts vous protègent. Peut -être que je pourrais juste compter sur vos efforts, tout en m’abstrayant des miens, dans un comportement de passager clandestin bien étudié par les économistes. La légèreté de beaucoup de nos concitoyens à appliquer les règles de distanciation sociale les plus élémentaires illustre parfaitement ce problème.
Il existe trois solutions pour répondre à ce comportement de passager clandestin inhérent à tout problème d’externalité, dans une pandémie comme pour le réchauffement climatique.
Le plan A applique le principe de responsabilité. Il consiste à faire payer aux individus la valeur des vies humaines perdues par leur comportement. Dans le cas du covid-19, ce plan est bien sûr impossible à mettre en œuvre puisqu’on ne peut pas établir le lien de cause à effet. Le plan B impose un « signal-prix » à toute personne désirant sortir de son confinement. Il consiste à faire payer à chaque personne se déplaçant un prix égal à la valeur espérée des dommages sanitaires que ce déplacement engendre. On pourrait par exemple mettre en place une « corona-taxe » proportionnelle à la durée de sortie de chaque citoyen.
Néanmoins, malgré les évolutions technologiques récentes, la mise en place d’une telle solution reste complexe et soulève des questions éthiques sérieuses. Il ne reste donc que le plan C, celui d’une politique aveugle de confinement de l’ensemble de la population tempérée par quelques exemptions. C’est l’approche sanitaire actuellement suivie par de plus en plus d’Etats.
Poursuivons avec la polémique sur l’utilité du confinement. On l’a vu, le coût économique et social va être sévère, avec une perte de richesse pouvant dépasser les 10% du PIB annuel, c’est-à-dire environ 250 milliards d’euros. Pour évaluer l’intérêt de cette politique, il faut comparer la perte qu’elle induit à celle du non-confinement qui, on l’a vu, pourrait conduire à une surmortalité d’un million de personnes. Comment comparer 250 milliards d’euros à un million de morts ? Pour rendre ces choses comparables, il faut d’une façon ou d’une autre fixer une valeur à la vie humaine. Il y a de nombreuses façons de répondre à cette question à l’intersection de multiples sciences sociales. Les économistes ont leurs méthodes, en étudiant comment les gens eux-mêmes valorisent leur vie. Chacun peut agir pour augmenter son espérance de vie, par des gestes simples de prévention (traverser la rue aux passages pour piétons, se brosser les dents, maintenir une activité physique,…) ou par des investissements de sécurité (changement de pneus, déménagement dans une zone moins polluée,…). Ces actions sont souvent coûteuses, et l’étude du comportement et des prix de marché permettent d’estimer une « valeur de la vie statistique ». En France, cette valeur est fixée à trois millions d’euros, en utilisant ce type de méthode. En d’autres termes, l’Etat est prêt à dépenser jusqu’à 3 millions pour sauver en espérance une vie entière (« Eléments pour une révision de la valeur de la vie humaine », Commissariat général à la stratégie et à la prospective, 2013). C’est ainsi qu’on estime par exemple le bénéfice de la réduction de la vitesse à 80 km/h sur nos routes, l’utilité d’une nouvelle autoroute, d’une maternité dans la commune de Le Blanc dans l’Indre, ou d’un nouvel IRM à l’hôpital de Toulouse. Estimons maintenant la valeur d’un million de morts du covid-19. Elle est probablement équivalente à la perte de 300.000 durées de vies entières compte tenu de la distribution de l’âge des victimes de ce virus. A 3 millions d’euros la vie entière, cela nous donne une valeur de cette surmortalité égale à 900 milliards d’euros. Elle est bien supérieure au coût estimé de 250 milliards d’euros de perte économique liée au confinement pendant deux mois. Sous ces hypothèses sanitaires et économiques, le message est donc clair. Entre les options du laisser-faire et du confinement, et même en faisant abstraction des questions éthiques évidentes dans ce cas, la seconde l’emporte largement sur la première. Peut-être devrions-nous traduire ce texte en néerlandais pour le gouvernement de Mark Rutte ?
Le confinement total est évidemment impossible. Il est indispensable que certaines activités essentielles soient maintenues dans l’agroalimentaire, l’énergie, les déchets et la sécurité, sans compter bien sûr la santé. Comment déterminer la politique des exemptions au confinement au-delà de ces cas évidents ? Comme pour toute décision individuelle ou collective, la sagesse nous dicte de comparer les coûts et les avantages de chacune des actions possibles. Le coût d’aller travailler correspond au risque de contracter la maladie et de devenir un vecteur de transmission. Selon le type de travail et l’état du système sanitaire, les modèles de transmission utilisés par les épidémiologistes doivent permettre d’estimer l’impact de cette action sur la surmortalité globale. On peut transformer cette information en une valeur économique en utilisant la valeur tutélaire de la vie humaine évoquée ci-dessus. Ce coût doit être comparé au bénéfice sociétal de l’activité engendrée. Pour un infirmier, un boulanger, un chercheur sur sa paillasse à la recherche du vaccin, il n’y a certainement pas photo. Le calcul est sans doute plus compliqué pour un enseignant ou un employé de banque, d’autant plus qu’existent aujourd’hui des solutions de télétravail relativement efficaces pour ces professions. Une fois les mesures sanitaires d’accompagnement définies, il faudra donc prévoir une politique progressive de sortie de confinement ciblée sur des professions variées, en utilisant cette méthode de coût-bénéfice.
Ces calculs diffèrent souvent selon qu’on adopte le point de vue individuel ou le point de vue collectif. En temps normal et avec un marché du travail sans friction, le salaire d’équilibre d’un emploi est égal à la valeur sociale de sa production marginale. Dans ce cas, il n’y a pas de différence entre les deux points de vue. Mais en période de crise, il est probable que la valeur sociale de certains emplois soit largement supérieure au salaire perçu par ces employés. On pense évidemment à l’ensemble des personnels hospitaliers, aux vendeuses dans les magasins d’alimentation et aux postiers par exemple. Dans ce cas, ces catégories de salariés peuvent se trouver en situation de considérer leur risque sanitaire comme excessif par rapport à leur rémunération, alors même que du point de vue de la société, leur travail est socialement désirable. L’exercice de leur droit de retrait conduirait alors à une défaillance du système. Faut-il en conséquence restreindre le droit de retrait ? Personnellement, nous penchons plutôt pour le versement de primes exceptionnelles pour réduire l’écart entre salaire et création de valeur sociale du travail correspondant. Au-delà de l’objectif de démonstration de notre gratitude collective envers ceux qui prennent des risques pour nous secourir, cette politique permet d’aligner les intérêts privés avec le bien commun, et de fédérer les énergies sur les activités les plus essentielles dans cette période de crise. Là encore, une fois la crise passée, il faudra réfléchir à la valeur sociale de ces activités sur le long terme et au possible réalignement permanent des rémunérations de certaines de ces professions, en première ligne en temps de crise. Finalement, n’ignorons pas l’importance des motivations intrinsèques (don de soi, volonté d’aider, plaisir pris à accomplir une tâche sociale ou humanitaire) de nos personnels soignants pour effectuer leurs missions. Les manifestations de gratitude de la population à leur égard, comme par exemple les applaudissements spontanés ayant lieu chaque soir à 20 heures, prennent ici toute leur importance.
Finalement, se pose la question des modalités de sortie du confinement. Un récent rapport publié sous la direction du professeur Neil Ferguson d’Imperial College, au Royaume-Uni, indique qu’une stratégie radicale de suppression de covid-19 du type de celles appliquées actuellement dans notre pays apparaît comme la seule susceptible d’éviter à court ou moyen terme la submersion totale du système de santé, mais nous exposerait selon les auteurs au risque d’un rebond significatif des contaminations dès que les mesures de distanciation sociale radicale seraient levées.
Cette problématique est intimement liée à celle des conséquences économiques de l’épidémie et des mesures prises pour l’enrayer. Il apparaît difficilement envisageable de prolonger un confinement systématique au delà des 4 à 8 semaines que devrait durer les mesures actuelles sans faire face à un coût économique et humain démesuré. Le temps de production et de déploiement d’un vaccin efficace contre le Coronavirus étant estimé à environ 18 mois, il est donc impératif que notre intelligence collective mette en place avant cela un dispositif de sortie de confinement qui permette progressivement une reprise de l’activité économique. Nous pensons qu’une telle stratégie est possible, et peut-être définie en profitant au maximum des multiples compétences présentes dans notre société, et en particulier en combinant les expertises des épidémiologistes et des chercheurs en sciences sociales. Celle-ci devrait combiner deux volets principaux.
Le premier repose sur le déploiement de tests à grande échelle. Une estimation rapide montre qu’en partant sur la base d’un coût unitaire de 100 euros, modalités de mise en œuvre incluses, on pourrait tester l’ensemble de la population française à un coût global égal à 7 milliards d’euros, soit moins de 0,3% du PIB. De toute évidence, il s’agit là d’une priorité absolue dans la situation actuelle, et c’est une somme minime si on la compare par exemple au coût estimé de 250 milliards d’euros. Si cela permettait de remettre plus de 90% de la population au travail, la réduction de la perte économique selon nos calculs initiaux serait de 225 milliards. L’analyse coût-bénéfice est donc vite faite en faveur de cette stratégie. Bien sûr, à très court terme de nombreux obstacles existent, comme le manque de réactifs ou d’autres intrants, ou l’absence de chaines de production dédiées. Mais les bénéfices potentiels justifient une mobilisation totale sur cet objectif, du type de celles imposées à l’appareil productif dans le passé en temps de guerre.
Le deuxième élément qui doit être combiné aux tests à grande échelle concerne le traçage, de manière à ce que les résultats de ces tests permettent d’identifier en temps réel l’ensemble des contacts que des personnes porteuses du virus auraient eu lors de leurs déplacements. L’identification des déplacements et des contacts à travers les signaux des téléphones portables rend de fait ce traçage possible et très efficace. Ceci est particulièrement important car il est maintenant reconnu que de nombreuses contaminations se font alors même que les porteurs sont asymptomatiques et donc dans l’ignorance du risque qu’ils représentent pour autrui. La combinaison de ces deux volets est ce qui permettra que les individus guéris ou non contaminés puissent progressivement reprendre leurs activités normales en toute sécurité, et que dans le même temps les personnes contaminées, porteurs sains ou malades, soient isolées ou soignées. C’est la condition d’un redémarrage progressif de l’économie, et donc d’un cercle vertueux indispensable, dans les deux à trois mois.
De nombreux articles récents font état du succès de ces stratégies, menées sous des formes proches en particulier en Corée du Sud, ou combinées à des mesures de distanciation sociale plus ou moins contraignantes, de Taiwan ou à Singapour. Le diable est néanmoins dans les détails. Il est clair en particulier que le succès de ces mesures dépend dans une large mesure de facteurs institutionnels et culturels très spécifiques aux pays qui les ont mis en œuvre, et que leur réplication dans notre société pourrait s’avérer difficile. Les chercheurs en science sociale et en particulier les économistes possèdent un savoir-faire important dans ce domaine. En premier lieu, l’utilisation de très grandes bases de données géolocalisées est aujourd’hui bien maitrisée. Par ailleurs, il est bien connu depuis de nombreuses années des économistes qui travaillent sur les politiques publiques, par exemple dans le cadre du développement international, que les différentes interventions publiques ne sont pas des objets que l’on peut transposer à volonté sans tenir compte du contexte, et que des programmes qui fonctionnent très bien dans certains pays peuvent être totalement inadaptés dans d’autres.
L’analyse économique a également développé depuis plusieurs décennies l’étude des mécanismes incitatifs, qui associés à des interventions publiques permettent de renforcer ou au contraire de décourager certains comportements. La mise en place d’une double stratégie de test et de traçage est susceptible de se heurter en France à des résistances importantes, par exemple liées aux préoccupations sur la vie privée ou à la stigmatisation que les tests peuvent générer. De même, le fait qu’une partie de la population, sans doute celle le plus à risque, ne dispose pas de téléphone portable adapté à un suivi rigoureux constitue un autre problème. Ces questions sont primordiales, car il suffirait qu’une petite fraction de la population échappe au dispositif pour rendre celui-ci ineffectif. Il est donc fondamental de mettre en place les mécanismes et incitations nécessaires au bon fonctionnement de la stratégie choisie. Déjà, des applications cryptées, permettant un traçage qui respecterait l’anonymat des utilisateurs, ont été lancées par exemple au MIT Media Lab ou à Singapour. De même, des subventions spécifiques, par exemple par le biais des abonnement mobiles, conditionnant les autorisations de sortie individuelles en fin de confinement à l’utilisation de ces technologies sécurisées, peuvent être mises en place et remplacer à terme les autorisations papier que nous utilisons actuellement.
Gestion des risques extrêmes
L’humanité fait face à de nombreux risques pouvant mener à son extinction. La peste aurait tué jusqu’à la moitié de la population européenne au milieu du XIVe siècle. Les pandémies importées d’Europe par les conquistadores en Amérique auraient essentiellement annihilé les populations autochtones deux siècles plus tard. Nous risquons aussi une nouvelle collision de la Terre avec un astéroïde, un risque qui pourrait être limité par une politique « interstellaire » ambitieuse. Le réchauffement climatique que nous nous infligeons à nous-même et aux générations futures est une autre illustration de ces risques extrêmes. Parmi tous ces exemples, seul le réchauffement climatique est certain de se produire. Au contraire, la probabilité annuelle de collision d’un astéroïde est probablement inférieure à un millionième. Le risque de pandémie de type grippe espagnole ou covid-19 est de nature centennale. Que devrions-nous être prêt à sacrifier de notre bien-être pour se prémunir collectivement contre ces événements très peu fréquents, mais d’une intensité extraordinaire ? La réponse à cette question devrait déterminer notre volonté à investir dans la recherche médicale (ou spatiale) autant que dans le nombre d’unités de soins intensifs.
Il ne fait plus de doute aujourd’hui que la France va manquer de respirateurs et de lits dans les urgences, comme c’est déjà le cas en Italie. Cela signifie-t-il que la France s’est mal préparée à la pandémie ? Bien entendu, si l’occurrence et l’intensité de cette pandémie avaient été certaines, il aurait été effectivement optimal d’investir dans autant de respirateurs que de personnes en déficiences respiratoires, puisque leur coût est inférieur à la valeur de ces vies sauvées. Mais si la probabilité d’une pandémie est de 1%, une telle politique reste-t-elle optimale ? Bien sûr que non. L’argent public est rare, et il est crucial de l’allouer là où il crée le plus de valeur sociale. Investir dans des respirateurs qui ont peu de chance de jamais servir n’est probablement pas optimal, alors même que la France fait face à des besoins d’investissement criants dans le domaine de l’enseignement et du logement social pour ne prendre que deux exemples, et que d’autres crises liées à des évènements extrêmes sont également susceptibles de survenir. Critiquer l’Etat parce qu’il manque de respirateurs en période de crise sanitaire fait preuve d’un populisme certain.
Combien de respirateurs faut-il prévoir quand on ne sait pas combien seront nécessaires ? Ce problème est aussi vieux que celui de la gestion des stocks en entreprise, ou du marchand de journaux qui ne sait pas combien d’entre eux il pourra écouler dans la journée. Ce problème est dit du « marchand de journaux » en recherche opérationnelle, une discipline des mathématiques appliquées développée depuis la deuxième guerre mondiale. La stratégie optimale est très simple. Il est optimal d’investir dans un nombre de respirateurs tel que la probabilité de se retrouver en rupture de stock est égale au rapport du coût d’un respirateur par la valeur des vies sauvées grâce à son utilisation. Supposons que la survie d’un patient nécessite l’utilisation d’un respirateur pendant 2 semaines. Le prix d’achat d’un respirateur est d’environ 25.000 euros. Le coût de location pour 2 semaines ne doit donc pas être supérieur à 1.000 euros. Donc, en utilisant une valeur de la vie résiduelle sauvée de 1 million d’euro, on obtient que la probabilité d’être en manque de respirateurs ne doit pas dépasser 1 pour mille par quinzaine, ou encore 2.6% par an. Sur les 2600 quinzaines que compte un siècle, on devrait observer en moyenne pas plus de 3 quinzaines durant lesquelles notre pays est en rupture de respirateurs. Le fait que la pandémie covid-19 fasse partie de ces rares quinzaines paraît logique, sans que ceci ne signifie que la politique d’investissement sanitaire soit forcément critiquable.
Depuis l’affaire du sang contaminé, la France se fonde officiellement sur le principe de précaution pour gérer ses risques environementaux et sanitaires, malgré que son application opérationnelle reste extrêmement floue et sujette à des désaccords profonds d’interprétation. Certes, les théoriciens de la décision ont bien montré qu’un risque se mesure mieux par l’épaisseur des queues de distribution, c’est-à-dire de la fréquence des événements extrêmes, que par les écarts par rapport à la moyenne. Réduire la fréquence de ces événements extrêmes, ou en réduire l’intensité, a donc un impact considérable sur le bien-être collectif. Cela a un coût qui peut être important. Par exemple, l’achat massif de vaccins contre la grippe H1N1 en 2009 a coûté à la France environ un milliard d’euros pour une bénéfice dérisoire puisque l’épidémie ne s’est pas matérialisée et que les Français ont refusé de se faire vacciner. Cela ne signifie pas que cet effort de prévention était inefficace. Ne nous laissons pas emporter par le biais de rétrospection.
Rôle des marchés financiers et du système de retraite
Les fonds propres des entreprises constituent le premier coussin de sécurité du système capitaliste face aux fluctuations économiques. Tant qu’ils le peuvent, au niveau de ces réserves, ils assurent les salariés contre les aléas d’entreprendre. La volatilité des cours sur les marchés des actions est le reflet de cette assurance. Les actionnaires sont donc en première ligne pour porter le risque d’entreprendre, et c’est très bien ainsi. En effet, contrairement aux salariés qui peuvent difficilement diversifier leurs activités entre différentes entreprises, les actionnaires peuvent mutualiser leur risque dans une multitude d’actifs, de secteurs et de pays. Ils sont donc bien mieux placés pour porter les risques. Evidemment, les chocs macroéconomiques symétriques les plus extrêmes ne peuvent pas être éliminés par cette mutualisation, mais les actionnaires sont rémunérés grassement pour porter ce risque, de l’ordre de 6% par an sur le dernier siècle.
Dans le cas du covid-19, le renflouage direct des fonds propres des entreprises se justifie donc beaucoup moins que celui du revenu des ménages. Les marchés financiers doivent jouer leur rôle d’absorbeur de risque. Seul le risque d’insolvabilité et de perte du savoir industriel peut justifier un renflouement d’entreprises par l’Etat. Les annonces politiques récentes sur la protection des faillites vont dans ce sens.
En France, l‘actionnariat individuel est assez peu développé, ce qui implique que ce rôle d’amortisseur des chocs reste peu performant. Ceci va obliger l’Etat à utiliser plus d’argent public pour stabiliser notre économie et assurer les travailleurs. C’est en particulier parce qu’un avantage fiscal est proposé sur l’instrument d’épargne préféré des Français, l’assurance-vie en euro. Hors, ce contrat offre une garantie à 100% du capital investi, pour un total d’environ 1.400 milliards d’euros. Autrement dit, l’épargne des Français ne participe nullement au portage du risque collectif, qui doit pourtant bien être porté par quelqu’un ! En France plus qu’ailleurs, ce sera donc l’Etat qui subira l’essentiel des pertes. Cette garantie contractuelle conduit d’ailleurs les assureurs à investir dans des actifs sans risque, qui ne rapportent essentiellement plus rien. C’est aussi tout cela de perdu pour le financement de nos entreprises. A long terme, tout le monde y perd donc. La loi PACTE ne va probablement pas changer grand-chose dans ce paysage préoccupant de l’épargne des Français. Là aussi, c’est un important chantier de réflexion pour l’avenir.
Il est désirable que le système de retraite organise un partage des risques entre générations de Français. A nouveau, sous le voile d’ignorance, tout le monde préférerait vivre dans un monde où les chocs conjoncturels sont équitablement portés par tous. Dans le système de retraite à points, il serait donc logique que la valeur du point baisse temporairement l’année où les travailleurs subissent un choc aussi violent que celui du covid-19, en particulier si l’Etat ne parvient pas à compenser totalement les travailleurs.
*****
La pandémie covid-19 et le confinement des populations à grande échelle soulèvent des questions sociales et économiques nouvelles qui nécessitent des analyses inédites. Les données manquent (ou sont peu fiables) pour avoir une analyse précise de la situation et des bénéfices nets des politiques suivies. Néanmoins, la science économique offre des outils d’analyse qui nous semblent très utiles pour guider la décision publique, malgré ces incertitudes parfois radicales. Les semaines à venir vont être cruciales dans la gestion de la pandémie et de ses conséquences économiques, sociales et financières. Il serait désirable que ces outils soient mis en pratique à cette occasion.
La crise de 2008 avait déjà révélé une faiblesse de notre société due à « l’interconnexion » des banques, les risques financiers pris par l’une affectant les risques financiers portés par les autres. La crise de 2020 nous révèle une autre interconnexion, celle-ci entre les êtres humains, les risques sanitaires choisis par les uns affectant les risques sanitaires portés par les autres. Tes efforts me protègent ; mes efforts te protègent. Nous dépendons tous les uns des autres. Dans notre société hyper individualiste, cette leçon nous rappelle que le libéralisme ne peut pas tout. En l’absence du fait religieux, nous avons besoin de mécanismes de solidarité et de civilité entre les hommes que seul un Etat puissant et légitime aux yeux du peuple peut mettre en place. Parions que cette crise renforcera en chacun la conscience du lien social et du sens de notre responsabilité individuelle envers l’humanité. Elle nous montre aussi de façon resplendissante comment une volonté politique forte et décidée, guidée par la science, est capable de transcender nos individualismes pour éliminer un péril existentiel. Saurons-nous apprendre de cette expérience cathartique pour nous mobiliser demain contre l’autre guerre mondiale que nous devons urgemment mener, celle de la lutte contre le réchauffement climatique ?