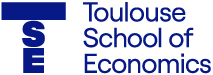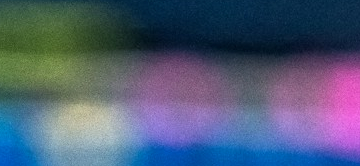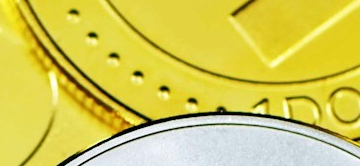Vos travaux sur les choix d’épargne et d’assurance vous ont amené à siéger au comité scientifique du Cercle de l’Epargne. S’il est possible de les résumer, comment présenteriez-vous vos recherches ?
« A l’époque où Denis Kessler présidait la Fédération française des sociétés d’assurance, il a suscité la création de plusieurs chaires d’économie de l’assurance. J’ai pris en charge celle de Toulouse et c’est comme cela que je me suis intéressé à la gestion du risque. Cela m’a amené à publier un livre sur la gestion patrimoniale qui a obtenu une reconnaissance au niveau international. Mes travaux portent sur l’aversion au risque des ménages, selon leur âge et l’horizon temporel de leur décision. Il est par exemple communément admis que les jeunes doivent prendre plus de risques dans leurs investissements et que, plus on se rapproche de la retraite, plus il faut être prudent. Le système du PERP oblige même légalement à réduire sa part de risque au fil du temps.
Personnellement, je pense qu’il y a là un malentendu. Je suis même devenu plus activiste que théoricien pour tenter de convaincre que le système de l’épargne en France n’est plus adapté et doit changer. Alors que ce sont les gens plutôt aisés qui épargnent et sur des durées essentiellement longues, avoir 1 600 milliards d’euros placés dans des actifs peu risqués, c’est aberrant ! L’assurance- vie a perdu son âme ! Sa vocation initiale était d’être un système de retraite par capitalisation avec une solidarité intergénérationnelle, ce qui ne s’expliquait qu’avec une dose de risque gérée dans le temps. Mais ce système est mort de sa belle mort à cause de l’avantage fiscal qui confère une attractivité trop grande aux fonds en euros et empêche toute évolution. Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. Si le système n’évolue pas, sa pertinence va se dégrader fortement… »
Il y a pourtant eu des tentatives pour inciter les Français à prendre plus de risques…
« Comme les fonds euro-croissance, par exemple, mais c’est un échec, car on ne peut pas réformer un système en lui rajoutant juste une couche d’innovation, sans réduire l’intérêt du dispositif existant. Il faut que les gens relativement aisés acceptent de porter une partie du risque lié à l’entreprenariat. Et pour cela, il faut une carotte fiscale pour ceux qui acceptent de bloquer leur épargne sur une longue période avec une dose de risque. »
Qui doit intervenir pour modifier le système, les assureurs ? Et comment faire évoluer les mentalités ?
« Un assureur ne pourra rien faire en solo. La profession, peut-être… Quant aux assurés, ils n’ont pas conscience des problèmes et pensent que l’Etat viendra de toute façon à la rescousse des sociétés d’assurance en cas de problème de solvabilité. Et puis, ils font preuve d’une grande irrationalité dans leurs choix, sans savoir résister à leurs envies immédiates et sans arriver à se projeter dans l’avenir, même s’ils savent très bien où se trouve leur intérêt… Non, seul l’Etat peut faire quelque chose. C’est lui qui doit changer les règles de l’avantage fiscal. »
Vous êtes l’un des contributeurs du groupe d’experts intergouvernemental sur le changement climatique. Comment en êtes-vous venus à vous intéresser à l’environnement ? Les travaux de ce GIEC sont encore contestés par des climatosceptiques, comme Donald Trump aux Etats-Unis. Y a-t-il encore une place pour un débat dans ce domaine ?
« Il y a un lien entre l’épargne et le changement climatique dans la manière d’aborder ces deux questions sur le long terme. De la même façon que je me suis demandé comment les 30-40 ans devaient épargner sur un temps long, j’ai été amené à réfléchir à la manière de valoriser l’action publique en faveur de l’environnement, dont les bénéfices ne se feront sentir que dans 100 ou 200 ans. Quand on émet une tonne de CO2 aujourd’hui, son impact en termes de dommages pour l’environnement va durer plusieurs siècles. Sachant cela, quel prix lui fixer pour nous responsabiliser vis-à-vis des générations futures en nous faisant payer les conséquences de nos actes ? Ce prix de la tonne de CO2 tourne actuellement autour de 5 euros, c’est bien trop peu !
Quant aux travaux du GIEC, j’ai participé aux rapports 4 et 5, le 4 ayant d’ailleurs reçu le prix Nobel de la paix. Mais j’hésite à continuer car c’est un travail très chronophage pour des rapports que personne ne lit et que les politiques triturent dans tous les sens… Enfin, concernant le débat sur le changement climatique, s’il génère beaucoup d’incertitudes ce n’est pas sur la réalité du phénomène, mais sur son intensité. Notre responsabilité humaine dans le réchauffement est clairement liée à la concentration de CO2 que nous générons. La question est de savoir si ce réchauffement sera de 1, 2, 3 ou 4 degrés avec toutes les catastrophes qui vont avec… »
Vous avez co-écrit un livre sur le principe de précaution. Comment considérer aujourd’hui ce souci permanent qu’ont les acteurs publics ou privés de limiter leur responsabilité en imaginant le pire ? Ne bride-t-il pas complètement l’initiative, la créativité ou l’action tout simplement ?
« Premièrement, on ne sait pas tout, la science n’a pas encore répondu à toutes les questions et on peut avoir des mauvaises surprises. Deuxièmement, compte tenu de cette incertitude, certains disent : « Faisons comme si le pire était certain ».
Je combats fortement cette approche, ne serait-ce que parce que les êtres humains ne se comportent jamais comme cela dans leur propre vie et je défends une vision équilibrée du principe de précaution. Oui, il faut prendre en compte les événements extrêmes dans le processus de décision, mais ce principe de précaution ne doit pas être utilisé avec une conception maximaliste, sous peine de conduire à l’immobilisme et à des crises de société. »
Dans un autre ouvrage collectif, vous évoquez le choc des générations face à la dette publique et au financement des retraites et de la dépendance. La génération des baby-boomers est-elle vraiment en train de vivre aux crochets des générations futures ?
« Il y a un vrai problème d’inégalité en France avec les baby-boomers qui concentrent les richesses. Nous ne sommes pas le seul pays concerné par ce phénomène : en Grande-Bretagne, le revenu moyen a stagné depuis dix ans, mais quand on aborde la question en fonction de l’âge, on s’aperçoit que les plus âgés ont vu leurs revenus continuer à progresser alors que ceux des plus jeunes s’effondraient. Et c’est encore pire dans le domaine du capital et du patrimoine. Ça ne peut pas durer et il faut réfléchir à un meilleur partage du fardeau des risques. En matière de retraite, il est inacceptable de laisser les plus jeunes assumer la totalité des risques conjoncturels, tout en assurant à 100 % le fonctionnement de notre système de répartition au bénéfice des plus âgés. Au lieu d’indexer les retraites sur les prix comme on le fait actuellement, il faudrait par exemple les indexer sur le PIB. Les plus âgés, qui sont souvent les plus aisés, doivent accepter d’être plus solidaires ! »
Le souhait d’Emmanuel Macron d’aller vers un système de retraite unique à points va-t-il dans le bon sens ?
« Oui, il faut plus de transparence et plus d’égalité. Il faut un système identique pour tous avec des correctifs bien sûr en fonction de l’âge et de la catégorie socio-professionnelle… » On reproche souvent à nos élus de lancer des investissements sous la pression des lobbys, de la mode du moment ou des électeurs qu’il faut bien courtiser pour se faire réélire. Vous plaidez, vous, pour une vraie évaluation des dépenses publiques. Pourquoi n’existe-telle pas en France ? « Je milite, c’est vrai, pour l’instauration d’un vrai organe d’évaluation indépendant qui interviendrait au moment de l’élaboration des lois pour éclairer le Parlement sur ses choix, puis quelques années plus tard pour faire un bilan des actions entreprises afin de les réorienter si besoin, d’ajuster le tir en quelque sorte. On peut dire ce qu’on veut des Etats-Unis, mais lorsque Trump a voulu mettre fin à l’Obama Care, un organisme public d’évaluation a établi le montant de la facture en disant aux élus : « Si vous supprimez ce dispositif, 25 millions de personnes ne pourront plus se soigner. » J’aime bien cette idée de mettre les représentants du peuple devant leurs responsabilités… Chez nous, ce sont les élus qui décident sans que l’on sache vraiment quel va être l’impact économique et social de leur action. La Cour des comptes ne fait qu’un contrôle a posteriori en vérifiant la compatibilité des décisions avec la loi, car elle n’a pas vocation à faire une analyse coût/bénéfice. »
Que vous inspire la révolution digitale que nous sommes en train de vivre ?
« C’est un sujet crucial auquel la Toulouse School of Economics consacre une chaire. Nous sommes en train de changer de société ! Cette révolution va transformer le monde, mais va aussi détruire des emplois. Il va donc falloir reprofiler notre capital humain en fonction des nouveaux besoins en emploi qui vont naître et cela pose la question du devenir de ceux qui ne pourront pas s’adapter… »
© droits reservés Amphitéa Magazine