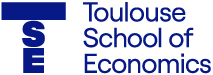En 1970, le futur prix Nobel de chimie néerlandais Paul Crutzen démontra les dangers posés par la destruction de la couche d'ozone. Moins de vingt ans plus tard, la signature du protocole de Montréal contribuait à enrayer ce phénomène susceptible de provoquer des cancers de la peau en masse.
En 1965, le président Lyndon B. Johnson avertit le Congrès américain du risque d'un réchauffement climatique selon un mécanisme découvert dès la fin du XIXe. Plus de soixante-dix ans plus tard, rien ou presque n'a été fait : les émissions des gaz « à effet de serre » n'ont fait qu'augmenter, le poids des énergies carbonées dans le mixte énergétique n'a pas évolué.
Sans coordination internationale, le coût du basculement vers une société bas carbone est bien trop élevé pour être politiquement acceptable. Dès lors qu'il s'agit de réaliser des investissements dans la transition énergétique, les modélisations macroéconomiques prévoient des effets positifs sur l'emploi à terme, mais les coûts d'adaptation sont considérables. En pratique, un tel changement menace en France des centaines de milliers d'emplois et exige des changements profonds de mode de vie. Surtout, l'investissement à engager, plusieurs trilliards de dollars par an, doit se porter pour les deux tiers dans les pays en développement. Il serait vain de chercher à convaincre nos concitoyens de réaliser des efforts considérables si le reste du monde ne suit pas.
Reculer pour mieux sauter
La stratégie de la France à cet égard revient à « reculer pour mieux sauter ». Elle passe par la fixation d'un coût par tonne de CO2 en deçà duquel devront être engagées les mesures de réduction des émissions, selon la règle dite du prix unique du carbone. La trajectoire retenue atteint 250 euros en 2030, devrait dépasser 700 euros au-delà de 2050, mais ce prix est inférieur à 50 euros aujourd'hui, ce qui revient à repousser l'essentiel des efforts à plus tard. Comme le montrent différents travaux récents d'économistes, cette trajectoire n'est pas adéquate, car elle n'est pas assez prudente au regard des risques en présence et parce que l'effet des émissions de CO2 sur la température de la planète est plus rapide que prévu.
Cette stratégie revient à renoncer à toute coopération internationale dans l'immédiat, car construite autour d'un objectif de « zéro émission nette » d'ici à 2050, limité durant une première phase au seul périmètre de la France. Localiser les efforts là où ils sont les moins coûteux à travers le monde pourrait permettre de diviser par plus de deux ce fameux prix du carbone requis pour limiter le réchauffement. Cela peut se faire en interconnectant les marchés d'émissions qui couvrent aujourd'hui près du quart des émissions mondiales, ou par des financements directs comme les « mécanismes de développement propre » du protocole de Kyoto. L'impact sur l'économie de chaque pays est complexe - car les prix et les termes de l'échange seront modifiés -, cela suppose des contrôles rigoureux et une gouvernance unique, mais cela peut changer la donne politique : les Français paieraient moins pour le climat en échange de transférer une partie des sommes vers les pays en développement
Il est nécessaire d'agir plus vite, plus fort. Cela ne sera politiquement acceptable qu'à travers une coopération internationale, en instaurant d'abord un prix unique du carbone au niveau européen, puis en s'inscrivant dans un cadre multilatéral où les pays développés financeront pour une part significative les efforts des pays en développement, comme ils s'y étaient engagés auprès des Nations unies en 1992.
Copyright - Les Echos