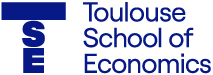La controverse récente sur le budget de la recherche a été l'occasion d'une nouvelle reculade du gouvernement. Un décret prévoyant de réduire les crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche de 256 millions a suscité une vive réaction de la part de huit prix Nobel et une médaille Fields, puis, dans la foulée, une immédiate rétractation de l'exécutif.
Clairement, la recherche française est en crise profonde. Elle vit sur ses acquis, mais les tendances ne sont pas bonnes. Premièrement, à l'inverse de la Suisse ou du Royaume-Uni, la France n'est pas attractive pour les grands chercheurs étrangers. Or, l'impact sur l'écosystème local de ces « chercheurs stars » est important. La technocratique gestion des carrières du « chercheur fonctionnaire » n'intègre pas qu'il s'agit d'une population devenue internationalisée et mobile, sensible non seulement aux rémunérations mais surtout aux conditions de travail. La bonne analogie pour réfléchir au recrutement de talents étrangers, c'est davantage le milieu du football ou de l'art que celui des patrons du CAC 40 ou des conseillers ministériels. Deuxièmement, la France est un pays où la formation par la recherche n'est pas valorisée. Les jeunes docteurs y sont considérés comme des étudiants attardés. Le décalage est total entre la Silicon Valley, où les entreprises de technologie s'arrachent au prix fort les thésards scientifiques, et la French Tech, qui valorise plutôt un diplôme d'école de commerce (pour créer un concept vite revendable à un grand groupe) ou un carnet d'adresses dans la haute fonction publique (pour obtenir les subventions). Troisièmement, les financements français issus du grand emprunt sont saupoudrés au lieu d'être concentrés sur les équipes les plus à la pointe.
Ce constat n'est pas nouveau, il faut donc comprendre ce qui bloque : le management de la recherche est devenu assez incompatible avec une organisation de conglomérat centralisé. Les problèmes d'incitation sont très subtils dans ce milieu : l'effort d'un chercheur ne se mesure pas au nombre d'heures de travail, et les publications importantes peuvent mettre des années avant de se matérialiser. L'évaluation interne dans les organismes est souvent entachée par le lobbying et les connexions, et la difficulté qu'ont les grandes organisations à « retirer la prise » des projets qui patinent. A cela s'ajoute le fait que les percées scientifiques nécessitent davantage de temps et de maturation qu'autrefois : prétendre sélectionner les talents à vingt ans une fois pour toutes, comme le fait le système des grandes écoles, est moins logique qu'au XIXe siècle.
L'origine du mal, c'est la centralisation à outrance de la recherche publique française. Elle empêche une allocation optimale des ressources publiques entre équipes de chercheurs. Pour éviter de fâcher certaines disciplines ou certaines équipes, la technostructure centralisée est condamnée à saupoudrer les crédits et à garantir un certain égalitarisme parmi les chercheurs. Conscient de ces dysfonctionnements mais sans volonté de changer de paradigme, l'Etat fait le choix du rationnement des crédits de recherche et de l'aide à la R&D privée.
Pour sortir de cette impasse, il faut assumer une restructuration en profondeur de notre recherche publique, avec d'un côté un grand nombre d'organismes autonomes (universités, instituts) en concurrence pour obtenir les fonds et embaucher les équipes, responsabilisés financièrement, libres de nouer des partenariats privés et de vendre leurs prestations d'enseignement ; de l'autre, une poignée de grandes agences de moyens, ciblant les crédits de recherche sur les équipes ayant le meilleur « track record » de long terme en utilisant des jurys étrangers.
On peut aussi renoncer à une recherche fondamentale d'excellence et choisir d'installer le pays dans le wagon passagers de l'innovation. Les chercheurs iront s'installer ailleurs ; la science continuera sa marche, et nous paierons des royalties aux inventeurs étrangers pour utiliser les dernières technologies.