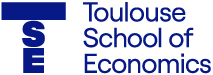Les penseurs du siècle des Lumières, ainsi que leurs prédécesseurs, réfléchissaient aux comportements des individus et des groupes sociaux sans faire de distinction entre les sciences sociales. Adam Smith avait par exemple publié, dix-sept ans avant son célèbre traité La Richesse des nations, un livre remarquable intitulé La Théorie des sentiments moraux. Ce n’est que progressivement – et essentiellement au XXe siècle – que les différentes cloisons scientifiques sont apparues, séparant artificiellement les activités humaines en différents objets d’étude, pour lesquels des méthodes d’analyse et de compréhension ont évolué chacune de leur côté. Pourtant, toutes les sciences sociales partagent bel et bien un même sujet d’étude, les mêmes individus et les mêmes groupes sociaux.
L’économie, par exemple, a construit son identité propre au XXe siècle, à travers, d’une part, une emphase particulière sur des méthodes statistiques et quantitatives, et, d’autre part, le concept d’homo economicus. Cet homo economicus est supposé défendre rationnellement ses intérêts, compte tenu de l’information dont il dispose. Un apport essentiel de cette approche et des recommandations associées est la mise en exergue des différences qui peuvent exister entre rationalité individuelle et collective : ce qui est bon pour un acteur économique n’est pas forcément bon pour l’ensemble de la société.
Par exemple, un individu, une entreprise ou une administration peuvent choisir de polluer l’environnement plutôt que de réduire leurs activités ou de les rendre plus vertes ; une entreprise ou une banque peut abuser de son pouvoir de marché ou prendre des risques inconsidérés, au détriment des consommateurs ou du contribuable ; un politicien pourra faire passer sa carrière politique avant l’intérêt général en choisissant des politiques populaires mais contraires au bien commun, etc. Plus généralement, les économistes ont mis en exergue ce qu’ils appellent des « défaillances de marché » et des « défaillances organisationnelles », et ont conçu des politiques permettant de les pallier.
De l’abstraction au réalisme
L’abstraction de l’homo economicus s’est avérée très utile, mais elle ne fait pourtant pas longtemps illusion lorsqu’elle est soumise à l’épreuve de certains faits. Nous ne nous comportons pas toujours Jean Tirole à l’Ecole d’économie de Toulouse, en octobre 2014. AP / Fred Scheiber aussi rationnellement que le suppose la théorie, et avons des objectifs complexes, qui diffèrent entre individus. Nos choix peuvent ainsi être mus par une empathie, qu’elle soit réelle ou de façade (nous avons le souci de projeter une bonne image aux autres et aussi à nous-mêmes, un trait qui occupe une place prépondérante dans certains de mes travaux avec Roland Bénabou).
Ces mêmes choix peuvent dépendre de notre humeur du moment, de notre stress ou de notre fatigue. Ils peuvent souffrir de procrastination, c’est-à-dire de la tendance à maximiser notre bienêtre à un instant donné au détriment de notre bien-être futur, parfois au prix d’une réduction de n’investissons pas assez dans les relations humaines. Nous sommes enfin victimes de nombreuses erreurs cognitives. L’humain est bien plus complexe dans sa prise de décision que ne le décrivaient les économistes du XXe siècle. Au-delà de la psychologie, tout un corpus de savoirs fut négligé : sociologie, anthropologie, histoire, droit, sciences politiques, sciences de l’évolution… Cette remise en cause de l’homo economicus a peu à peu poussé l’économie à se rapprocher des autres sciences sociales, afin de mieux comprendre les comportements humains et ainsi améliorer ses connaissances, ses modèles et ses théories. Ce faisant, les économistes ont beaucoup appris et le nombre de théories économiques directement influencées par une ou plusieurs autres sciences sociales est en croissance rapide depuis les années 1980 ; cette tendance est déjà reflétée par l’attribution de trois prix Nobel d’économie liés au comportementalisme (Daniel Kahneman en 2002, Robert Shiller en 2013, Richard Thaler en 2017) et un aux sciences politiques (Elinor Ostrom en 2009). L’homo economicus a vécu, remplacé par un humain plus complexe, plus aléatoire, plus difficile à comprendre et à étudier, mais aussi plus réaliste.
Complexité humaine
Parmi les nombreux apports des sciences sociales à l’économie, on peut citer l’incorporation de l’homo socialis. Les sociologues insistent, à juste titre, sur l’importance de ne pas analyser l’individu hors contexte, c’est-à-dire sans considérer son environnement social. L’individu fait partie de groupes sociaux et ces groupes affectent de multiples manières la façon dont il va se comporter : transmission de culture et de croyances, pression sociale, recherche d’identité et d’appartenance au groupe, confiance en autrui, influence de la réputation d’un groupe social sur les individus y appartenant, « narratifs » qui circulent au sein du groupe, structures d’autorité réelle et formelle, etc. J’ai, avec mes coauteurs, travaillé sur plusieurs de ces sujets, comme beaucoup d’autres économistes. Plus généralement, les différentes sciences sociales ont bousculé notre vision de l’homo economicus, que ce soit au travers de sa psychologie, de ses comportements hérités d’une longue évolution et du contexte historique, de sa boussole morale qui traduit sa vision idéale de la société dans laquelle il vit ou de sa considération pour le cadre légal dans lequel il évolue. Les économistes apprennent peu à peu à prendre en compte la complexité humaine dans leurs travaux, aidés par les apports de l’anthropologie, du droit, de l’histoire, de la philosophie, de la psychologie, de la science politique et de la sociologie. Cette vision d’une plus grande transversalité au sein des sciences humaines et sociales m’a convaincu, ainsi que mes collègues, de la nécessité de créer un nouveau type de centre de recherche. En 2011, l’Institut des études avancées de Toulouse (Institute for Advanced Study in Toulouse, IAST), dirigé par Paul Seabright, a vu le jour avec pour mission la facilitation de projets de recherche multidisciplinaires. Avec une cinquantaine de chercheurs issus d’une dizaine de disciplines et un important réseau international de visiteurs, cette initiative a été un franc succès, d’une part en créant une vie scientifique riche et un intérêt croissant des communautés scientifiques internationales pour ce type de travaux, d’autre part en facilitant le rapprochement des économistes de l’Ecole d’économie de Toulouse avec les autres sciences sociales.
Réunification scientifique
Parmi les thèmes sur lesquels les chercheurs de l’IAST ont déjà publié des travaux pluridisciplinaires, on trouve : les défis éthiques des véhicules autonomes (par le psychologue JeanFrançois Bonnefon, dans Science en 2016 et Nature en 2018) ; les maladies du vieillissement chez les communautés indigènes en Amazonie (par l’anthropologue Jonathan Stieglitz dans The Lancet en 2017) et l’impact du changement économique sur la coopération au sein de ces communautés (par Jonathan Stieglitz et l’économiste Astrid Hopfensitz dans Evolution and Human Behavior en 2017) ; le rôle bénéfique du partage de l’information au sein des groupes (par le mathématicien Adrien Blanchet et le biologiste Guy Théraulaz dans Proceedings of the National Academy of Sciences en 2017) ; les biais dans les décisions des juges et des jurys (par l’économiste et juriste Daniel Chen dans Quarterly Journal of Economics en 2016 et l’économiste Arnaud Philippe dans Journal of Political Economy en 2018). Cette ouverture est cependant complexe à mettre en œuvre, notamment parce qu’elle suppose, pour le chercheur, de remettre en cause ses connaissances et théories et d’apprendre les méthodologies et travaux majeurs d’autres disciplines. Aujourd’hui, cette ouverture se limite le plus souvent à un croisement entre deux disciplines et une influence, par exemple, de la psychologie sur une étude d’économie, ou de l’économie sur un projet de recherche en histoire. Ces croisements bilatéraux sont un excellent début, mais ne sauraient être un aboutissement satisfaisant du rapprochement en cours des sciences sociales. Je pense que la science sociale de demain sera plus unifiée qu’aujourd’hui et que les scientifiques y laisseront peu à peu disparaître leurs différentes étiquettes pour qu’elles soient reléguées au second plan d’un ensemble unifié de connaissances. De nouvelles formations interdisciplinaires, telle que celle que nous ouvrons à Toulouse, seront nécessaires pour que cette réunification ait lieu. Les chercheurs de demain devront être formés aux différentes méthodes et outils de toutes les sciences sociales et en comprendre les points de vue afin de mieux les combiner et ainsi atteindre une
compréhension et une analyse de l’humain plus justes et plus précises. La réunification nécessitera de la part des différentes communautés scientifiques beaucoup de temps, d’efforts, d’ouverture aux techniques et aux idées des autres disciplines, ainsi que le développement d’institutions de recherche et de formation allant dans ce sens.
Article publié dans Le MONDE, 5 octobre 2018.