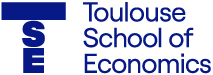Les baby-boomers sont les grands gagnants de notre système par répartition. C'est sur eux qu'il faudrait faire peser une bonne partie du rééquilibrage budgétaire, tout en rendant le mécanisme plus redistributif à l'intérieur d'une génération, explique l'économiste Frédéric Cherbonnier.
Afin de faire face à notre dette publique, soutenir le pouvoir d'achat, investir pour l'avenir, il nous faut relever le taux d'emploi des seniors. Cela passe par un durcissement des conditions d'accès à la retraite - âge légal et conditions pour un départ anticipé. Mais dans le contexte budgétaire et politique actuel, cela n'est possible qu'en allant vers un système plus équitable.
Premier angle d'approche : l'équité intergénérationnelle, jaugée en analysant l'écart entre cotisations versées et pensions perçues. Selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR), les plus de 75 ans ont bénéficié d'un « taux de rendement interne » de près de 2 %. Ce taux correspond au rendement réel équivalent dans un système par capitalisation, soit le taux de rémunération qu'aurait retenu un assureur pour capitaliser les cotisations et les transformer à terme en une rente viagère d'un montant équivalent. Pour les Français actuellement en activité, ce taux sera beaucoup plus bas, il devrait passer sous la barre de 0,5 % pour ceux qui aujourd'hui ont moins de 50 ans ! Résultat de la moindre croissance de l'activité économique et des mesures prises pour faire face au vieillissement de la population : désindexation des retraites de l'évolution des salaires, allongement de la durée de cotisation, etc.
Second angle d'approche : l'équité intragénérationnelle, liée en grande partie aux inégalités de santé. Sur ce point, la question de la pénibilité au travail est l'arbre qui cache la forêt. Elle n'explique qu'une petite partie des écarts de santé, alors que le débat en France devrait davantage se porter sur le caractère antiredistributif de notre système de retraites - les catégories populaires décédant en moyenne trop tôt pour bénéficier pleinement de leur droit à la retraite, et finançant à la place celle des cadres !
Une large part de déterminisme social
Les écarts d'espérance de vie résultent pour une large part d'un déterminisme social : les catégories les plus pauvres (le premier décile de revenu) ont la même espérance de vie à 59 ans que la moyenne de la population à l'âge de 64 ans, cet écart se transmet généralement de génération en génération et justifierait de rehausser de 30 % le niveau des pensions de ces catégories (afin de leur faire bénéficier du même taux de rendement interne sur leurs cotisations que le français moyen). L'idéal serait de faire du cas par cas, via un examen médical au moment du départ à la retraite pour qu'un tel ajustement soit fonction de l'état de santé précis de chacun, mais cela semble bien impraticable !
Que faire ? Les baby-boomers sont les grands gagnants de notre système par répartition, c'est donc sur eux, les retraités actuels, qu'il faudrait faire peser une bonne partie du rééquilibrage budgétaire. Et pour le reste, s'inspirer des meilleures pratiques chez nos partenaires. Afin de rendre le système plus redistributif, il faudrait mettre en place un taux de remplacement plus élevé pour les petites retraites, à l'instar de ce qui est fait dans le régime de base aux Etats-Unis de façon extrême : le niveau de la pension y passe progressivement de 90 % du revenu pour une personne pauvre à seulement 30 % pour les plus aisées.
En France, pour une catégorie de travailleur donné, le taux de remplacement est quasiment constant dès lors que l'on se situe entre les minima sociaux (minimum contributif, allocation de solidarité) et le plafond de la Sécurité sociale. Et en ce qui concerne la pénibilité, l'idéal serait, à l'instar de l'Allemagne, d'inciter les partenaires sociaux à négocier des accords de branche identifiant les métiers pénibles, et à s'accorder sur un surcroît de cotisations sociales finançant préretraites ou travail à temps partiel. Cela responsabiliserait au passage les entreprises, les incitant à lutter davantage contre la pénibilité au travail.
Article paru dans Les Echos, le 9 février 2025
Illustration Photo de Huy Phan sur Unsplash